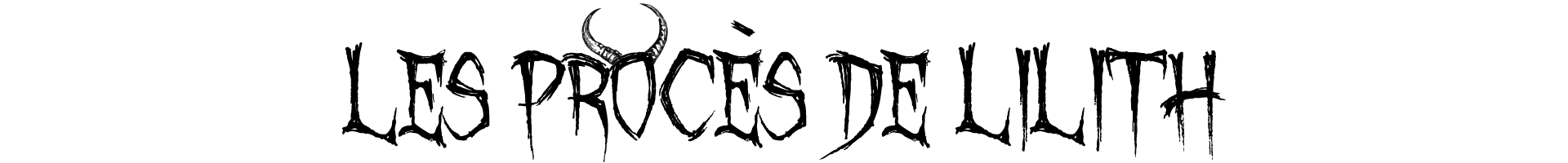Slasher : mes Final Girls préférées de ces dernières années
Le slasher est mon petit péché mignon cinématographique. J’adore découvrir les nouvelles sorties de ce genre, visionner les films qui me sont encore inconnus. J’aime par-dessus tout revoir mes grands classiques. D’ailleurs, je profite chaque année du mois d’octobre pour visionner mes préférés et ainsi me mettre dans l’ambiance d’Halloween.
Le slasher constitue un sous-genre de l’horreur qui répond à une multitude de codes et de références. La « final girl » en est l’un des plus emblématiques.
Globalement, ce concept repose sur l’idée que tous les personnages du film sont tués, sauf une femme : la « dernière survivante ». Apparu dans les années 70, il apparaît comme une véritable évolution dans le genre horrifique. La présence féminine est plus souvent associée au rôle de victime que d’héroïne. Il a vite été critiqué, car la survie de sa protagoniste relevait le plus souvent de sa pureté physique et morale.
Heureusement, le slasher est un genre qui adore se remettre en question et jouer avec les stéréotypes. Ainsi, le terme final girl s’est progressivement transformé pour évoluer avec notre société. Aujourd’hui, il nous offre des survivantes emblématiques et surtout diverses.
Laurie Strode et Sidney Prescott des franchises Halloween et Scream ont ouvert la voie. Dorénavant, la final girl est avant tout une jeune femme complexe, subversive et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds.
En ce jour d’Halloween, je vous propose de découvrir quelques unes de mes final girls modernes préférées.
Petite précision : L’article contient évidemment des méga spoilers sur les quatre films mentionnés. Allez visionner ces films (si vous le voulez bien sur) avant de le lire.
Tree Gelbman – Happy Death Day (Jessica Rothe) 2017

Dans Happy Death Day (intitulé Happy Birthdeath en France), Theresa « Tree » Gelbman est sauvagement assassinée le jour de son anniversaire. Mais se réveille mystérieusement le matin même, avant sa mort. Eh oui ! Tree est coincée dans une boucle temporelle, où elle continue de revivre la même journée et mourir. Ce n’est pas tout ! En plus de ça, un tueur en série tente également de la chasser et de la tuer. La jeune femme doit alors se battre contre le temps pour deviner l’identité du tueur, et pourquoi elle se retrouve piégée dans cette boucle temporelle. Classé en tant que comédie horrifique, le film revisite de nombreux codes du slasher. On comprend donc très vite que Tree est notre final girl et qu’elle va s’en sortir. Et pourtant, elle ne ressemble en rien à l’héroïne typique, liée à ce genre.
Tout d’abord, lorsque le film commence, la jeune fille ressemble plus à l’archétype de la « bimbo ». Membre d’une sororité, on la découvre impolie, superficielle, cynique et particulièrement méchante. Elle ignore les appels de son père depuis le décès de sa mère, elle couche avec son professeur marié, elle a un comportement immonde avec sa colocataire… Bref, la liste de ses ennemies est plutôt longue.
Dans un slasher « classique », Tree est clairement la fille méchante qui meurt horriblement dès le début du film. C’est d’ailleurs ce qui se passe vu qu’elle est assassinée par le tueur au masque de bébé. La particularité, c’est la boucle temporelle qui va lui permettre de revenir et de devenir l’élément d’identification du récit. Au fur et à mesure que son nombre de morts augmente, la jeune femme évolue intelligemment, progresse dans son enquête et surtout se débrouille seule. Finalement, ces évènements vont lui permettre de devenir une meilleure personne.
Contrairement aux autres films du genre, dans Happy Death Day, le but n’est pas seulement de survivre au tueur et le vaincre. Au contraire, Tree doit surtout apprendre de ses erreurs et grandir en tant que personnage. C’est ce qui la tue qui la rend plus forte.
Imparfaite et moralement complexe, elle incarne une nouvelle icône du slasher. Elle n’est pas seulement la « survivante », elle est le personnage central (contrairement au tueur comme dans la majorité des autres films) qui nous rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour s’amméliorer.
La croissance du personnage va un peu plus loin sur le plan émotionnel, dans le sequel Happy Death 2U. Cette fois-ci, les amis de Tree sont également bloqués dans la boucle temporelle et la jeune femme devra se sacrifier plusieurs fois pour leur venir en aide.
Grace Le Domas — Ready or Not (Samara Weaving) 2019

Ready or Not (Wedding Nightmare en français) relate la nuit de noces atypique de Grace et d’Alex Le Domas. Les Le Domas sont une famille fortunée, dans le business des jeux de société et également très attachée aux traditions. Le jour de leur mariage, la famille invite le couple dans leur château et, selon la tradition, le nouvel arrivant doit piocher une carte qui définira le jeu auquel ils vont devoir tous jouer. Grace pioche le jeu de « cache-cache », mais comprend assez vite que sa belle-famille ne joue pas selon les règles classiques et qu’ils cherchent en réalité à la tuer. Pour survivre, elle doit tenir jusqu’au lever du jour.
Le personnage de Grace représente une version modernisée de la final girl. Elle est une personne volontaire, qui n’a pas peur de dire ce qu’elle pense et qui se bat sans relâche pour survivre. Elle est profondément traumatisée par ce qui lui arrive mais reste résolument forte.
Avec ce scénario, le film cherche à critiquer le mariage et ses traditions ancestrales et patriarcales. En s’opposant à sa belle famille et en les menant à leur perte, Grace s’extirpe du rôle que ce mariage lui aurait imposé et s’émancipe. D’ailleurs, la dernière scène iconique du film le résume parfaitement. On y voit la jeune femme dans sa robe de mariée complètement tachée de sang, quitter la maison qu’elle a incendiée et s’allumer une cigarette. Lorsque les pompiers lui demandent ce qui lui est arrivé, elle répond simplement « Je me suis mariée ».
Deena Johnson – Fear Street 1994 (Kiana Madeira) 2021

Adaptée des romans La Rue de la peur de R.L. Stine, la trilogie Fear Street se déroule sur différentes décennies (1994, 1978 et 1666) et dépeint les évènements inexplicables ayant lieu dans la ville de Shadyside.
Le premier volet, centré sur l’année 1994, se concentre sur Deena Johnson, son frère Josh et leurs amis confrontés à des meurtres mystérieux. Au fur et à mesure que les corps tombent, ils se rendent compte que le mal qui rôde n’a rien de naturel et que la malédiction, dont semble faire l’objet Shadyside, n’est peut-être pas qu’une simple rumeur. Deena doit alors, avec l’aide de ses amis, non seulement trouver un moyen de survivre, arrêter le mal, mais également essayer de sauver son ex, Sam, qui se révèle être la cible de ce phénomène paranormal. Un bon slasher traditionnel me diriez-vous ?
Oui, mais pas vraiment. Sam est une fille. Ce qui signifie que Deena, en plus d’être une femme de couleur, est également lesbienne. Deux caractéristiques qui, selon les stéréotypes assez conservateurs du slasher, lui garantissent une fin violente et sanglante au cours du film. Et pourtant, en tant que chef de file du groupe, l’adolescente se révèle rapidement comme notre final girl. C’est une jeune femme courageuse, déterminée, en colère et pleine de ressources ; une vrai « badass ».
À côté de ça, les autres protagonistes de Fear Street sont également intelligents et trouvent ensemble des moyens de mettre fin à la malédiction. D’ailleurs, le film ne se termine pas avec une seule fille mais bien avec plusieurs survivants, dont deux femmes qui s’aiment et deux hommes afro-américains. Du jamais vu dans le trope du slasher. D’autant plus qu’au cours du troisième film, on découvre que la sorcière Sarah Fier n’est pas à l’origine du mal, comme on nous le suggère depuis le début. Elle n’est finalement qu’une jeune femme accusée injustement, car son mode de vie ne plaisait pas à la société. Non, le grand méchant n’est d’autre que le shérif Nick Goode, l’homme blanc à succès. Quel symbole !
Finalement, Fear Street prône l’« empowerment » et la notion de fidélité à soi-même. C’est une histoire fascinante d’une adolescente qui s’attaque au patriarcat et qui gagne. Le tout, intégré habilement dans l’univers méta et ensanglanté du slasher.
Tara Carpenter, Sam Carpenter et Mindy Meeks – Scream (Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown) 2022

Situé 25 ans après les évènements du premier opus, le dernier film Scream, sorti en 2022, ramène les téléspectateurs à Woodsboro, où un nouveau tueur au masque de Ghostface a commencé une nouvelle série de meurtres. Lorsque Tara Carpenter est attaquée, sa sœur Sam revient dans sa ville natale pour s’occuper d’elle et tenter de découvrir qui se cache derrière le masque. D’anciens secrets sont également révélés, au fur et à mesure que le tueur cible des personnes liées aux évènements passés.
Aux termes du film, le nombre de final girls s’élève au nombre incroyable de cinq. En plus des invincibles Sydney et Gale, on retrouve trois autres adolescentes : les sœurs Carpenter, évidemment, et leur amie Mindy Meeks.
Cinq femmes d’origines et d’âges différents avec des parcours et des personnalités bien distinctes. Un tournant dans la franchise Scream.
Le premier « rebondissement » revient à Tara. Tous les films Scream débute par cette scène légendaire, où la première personne apparaissant à l’écran (et généralement l’actrice la plus connue du casting) répond au téléphone avant que Ghostface l’attaque sauvagement et l’assassine. Dans le dernier volet, Tara rompt avec cette tradition puisqu’elle survit à cette première attaque. D’ailleurs, on n’a jamais vu une final girl endurer autant de blessures brutales et survivre. Apparemment, elle aurait reçu autant de coups de couteau et de blessures que Sidney et Gale ont ensemble obtenus au cours des quatre précédents films !
Sa survie, elle la doit principalement à Sam qui se bat sans relâche pour sauver sa petite soeur. D’ailleurs, l’amour entre les deux sœurs est au cœur du film.
La plus grande révélation du film est que Sam est en réalité la fille de Billy Loomis (un des Ghostfaces original). En proie à des hallucinations, on s’attend évidemment à ce qu’elle suive les traces de son père et soit notre tueuse. Sauf, qu’elle ne l’est pas. Elle est même la cible des Ghostfaces actuels. Finalement, ses gènes et hallucinations lui permettront de détruire Richie (son petit ami) en lui assénant 20 coups de couteau. Ce meurtre sanglant présage-t-il un tournant de la final girl à la tueuse en série dans le sixième volet ? Affaire à suivre.
À mon sens, l’inclusion et la représentation sont de gros points positifs de ce cinquième volet. Il faut dire que la saga en avait grandement besoin. Pour la première fois, on nous offre des survivantes dans lesquelles un certain nombre d’entre nous peuvent se retrouver. Sam et Tara sont toutes les deux des femmes latines et racisées. Leur statut de final girl est donc une première pour la franchise. Et ce n’est pas les seules. Mindy, la nièce de Randy Meeks, qui le remplace en tant qu’individu obsédé par les films d’horreur, est la seule personne métisse et queer à survivre à une attaque de Ghostface. Elle finit certes blessée, mais elle survit.
Pour finir, la survie de ces cinq femmes symbolise la sororité, la confiance et le pouvoir. Autrefois, une seule protagoniste féminine survivait, très souvent par chance. Aujourd’hui, plusieurs femmes survivent grâce à leur intelligence, leur force et leur travail d’équipe. Dorénavant, la final girl n’est plus seule. Elles se soutiennent et réussissent ensemble, à vaincre leur ennemi.
Je ne vois pas de meilleure façon de terminer cet article que par ces quelques mots de l’une des plus emblématiques des final girls : « It’s your time to scream Asshole ! » (Sidney Prescott, Scream 3)